Sviatoslav Richter

portrait par Gabor Winkler Nemes
huile sur toile, 150x100cm, collection privée B.M.
Faire un film sans images, telle est l'impasse a priori sans issue à laquelle je me suis longtemps heurté pendant l'intense période de gestation de ce "Richter, l'insoumis", le dernier en date des grands fauves de la musique auxquels j'ai passionnément désiré consacrer les ressources émotionnelles que je me sentais capable de communiquer sous une forme cinématographique. Lorsque Richter et moi avons commencé à travailler à ce projet, dans son esprit il ne pouvait être question de caméra, et ce n'est qu'après près de deux ans d'un contact presque quotidien avec lui que je suis enfin parvenu à élaborer une structure de tournage qui lui soit acceptable. Je me suis largement exprimé par ailleurs à ce sujet (Voir en bas de page: "Richter", Editions Van de Velde/La Sept Arte) et n'y reviendrai pas ici. Cependant, quelles étaient les alternatives possibles? Utiliser les entretiens que j'enregistrais au magnétophone avec Richter comme narration d'un film exclusivement constitué d'archives de concerts, et au cours duquel pas une fois sa voix ne pourrait être identifiée avec un visage? Oui, j'aurais pu sans doute tirer de cette méthode un joli petit film documentaire traditionnel, mais qui n'aurait rien eu à voir avec la grande fresque que j'avais l'ambition de réaliser. Sinon, avoir recours à des témoignages? C'était là la méthode facile qui, à partir d'une thèse suffisamment vigoureuse, aurait permis de révéler les tensions et contradictions présentes dans la vie de tout artiste, de ficeler en réalité un gentil programme de "télévision" bien objectif, avec tout l'assortiment conventionnel des jugements critiques "pour" et "contre", du débat, et débouchant, comme presque toujours, sur l'hagiographie. Je résistais à cette idée de toutes mes fibres. Je faisais un film sur un personnage hors-normes qui était le contraire de la convention, qui n'avait rien de "gentil", et si "tensions et contradictions" il y avait, elles apparaîtraient bien d'elles-mêmes dans les propos que je lui ferais tenir, dans sa manière toute personnelle, pleine d'humour et d'amertume de raconter sa propre histoire. Il n'y aurait ni apport extérieur au sujet, ni même commentaires, à l'exception d'un texte que j'écrirais et que je placerais en tête du film, accompagné du mouvement lent de l'ultime sonate de Schubert qui conclurait également une œuvre que je voulais passionnément subjective, ou bien alors qui ne serait pas. Je crois que si Richter s'est finalement prêté au tournage avec une caméra, c'est que, consciemment ou non, il avait saisi en moi cette volonté farouche d'échapper aux conventions du portrait.

à la fin du tournage de "Richter, l'insoumis" - Antibes, 1997
Les artistes-interprètes avec lesquels je me sens une véritable affinité, ceux qui me semblent les seuls vraiment importants, sont ceux qui dépassent l'instrument qu'ils pratiquent; ceux qui, voyageant à l'intérieur d'eux-mêmes, ne se contentent pas d'utiliser les paramètres de l'instrument pour exprimer la musique. Ce n'est pas parce que la corde de sol sonne de façon flatteuse qu'elle doit être mise à contribution dans telle variation de la Chaconne de Bach. L'instrument n'est plus qu'un instrument, il ne dicte pas la pensée musicale, et on ne l'exploite pas pour faire briller sa relation avec lui, mais pour donner à l'auditeur une impression d'intimité avec la musique. Parmi tous les grands instrumentistes avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, Richter est l'un de ceux qui donnent le plus fort ce sentiment de "dématérialiser" la musique. Tel un canon qui tirerait un obus sans recul, un avion qui s'envolerait verticalement sans élan, il est capable de varier les couleurs à l'infini et sans dégradé, de passer du pianissimo le plus impalpable au fortissimo le plus volcanique sans césure ni force d'inertie. S'il donne parfois l'impression d'une lutte avec la matière, c'est pour la pulvériser, et laisser naitre le chant pur, dans l'ivresse des pièces les plus hystériquement virtuoses où ses doigts font reculer les limites du physiquement possible, comme dans l'extrême lenteur d'adagios qu'il sait, comme personne, habiter d'un sentiment de totale immobilité.
La carrière menée par Sviatoslav Richter, l'impact qu'il a eu sur le public aussi bien que sur ses collègues (il est le seul à propos duquel se fasse l'unanimité pour dire qu'il est l'un des plus grands pianistes de l'histoire) sont irréductibles à tout modèle classique. Après une enfance et une adolescence presque sauvages, dépourvues de toute formation académique, et qu'il passe à Odessa où il apprend seul le piano et la musique, et où il est, dès l'âge de quinze ans, répétiteur à l'Opéra, il débarque à Moscou en 1937.
A un âge où la plupart des grands pianistes démarrent une carrière, lui devient étudiant. Heinrich Neuhaus, l'un des pianistes soviétiques les plus réputés de l'époque, subjugué par le "génie" de cet inconnu l'accepte immédiatement dans sa classe du conservatoire de Moscou où Richter va suivre une scolarité complètement marginale. Refusant (cela semble impensable; nous sommes en pleine période stalinienne!) de se plier aux disciplines auxquelles chacun est tenu de se soumettre (l'établissement dispense un enseignement "politique" évidemment obligatoire), Richter est à deux reprises chassé du conservatoire, mais à chaque fois réadmis sur les instances de Neuhaus. Prokofiev le remarque et lui demande de jouer sous sa direction son cinquième concerto "qui n'a aucun succès lorsque lui, Prokofiev le joue". Le succès remporté est retentissant; nous sommes en 1941, et ce n'est pas tant une carrière qui est lancée qu'une légende qui est née.

Moscou
A partir de cette date, Richter sillonne l'Union Soviétique, élargissant progressivement son répertoire jusqu'à des proportions probablement inégalées (sans compter la musique de chambre, et une quantité d'opéras, dont la totalité -texte et musique - de l'œuvre wagnérienne, il a dans la tête et dans les doigts, à la fin de sa vie, l'équivalent de quatre-vingt programmes de récitals). Cependant, pour des raisons peu claires, et qui sont en réalité d'origine familiale, il n'est pas autorisé à se rendre à l'étranger, si ce n'est dans les pays du bloc socialiste. Mais Richter ne sollicite rien, n'ambitionne rien, que ce soit en termes de gloire internationale ou de confort personnel, contrairement à la plupart de ses collègues, auxquels seules des tournées de concerts en occident peuvent ouvrir quelques perspectives d'amélioration de leur situation matérielle. Il est également le seul des grands solistes de sa génération et de son pays à écarter, moins par volonté délibérée que par radicale indifférence - ce n'est pas un rebelle, mais un réfractaire - toute appartenance au Parti Communiste. Une carrière exclusivement soviétique ne lui fait pas peur, il n'a en fait peur de rien. Il n'offre aucune prise, ce sera sa grande force.
Lorsqu'il se rend enfin à l'Ouest, en Finlande au mois de mai 1961, puis aux Etats-Unis, en octobre de la même année, il a quarante-six ans. Ses débuts en Amérique, avec une série de huit récitals et concerts avec orchestre à Carnegie Hall, font sur le monde musical l'effet d'un tremblement de terre. Puis ce sera l'Europe, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays scandinaves, et finalement le Japon, parcourus en tous sens tout au long des années soixante.

Moscou
Il ne va pourtant pas se prêter bien longtemps aux conventions du circuit international des concerts; allergique à toute planification, il joue où et quand bon lui semble, imposant souvent des programmes hors-normes à des publics médusés par la puissance tellurique comme par les infinies délicatesses de son jeu.
Après quatre tournées aux Etats-Unis, il décline toute nouvelle invitation à se produire dans ce pays qu'il abhorre, à l'exception, dit-il, de trois choses: "les musées, les orchestres, et les cocktails".
Il crée un festival en France (les "Fêtes musicales de Touraine" à la Grange de Meslay près de Tours) en 1964, puis un autre à Moscou (les "Soirées de Décembre" au Musée Pouchkine), mais disparait aussi parfois pendant des mois.
Il s'adonne avec un plaisir manifeste à la musique de chambre, en compagnie de partenaires réguliers qui s'appellent Mstislav Rostropovitch, David Oïstrakh, le quatuor Borodine, accompagne des chanteurs, Nina Dorliac, Dietrich Fischer-Dieskau, dans des récitals de Lieder, joue avec de nombreux jeunes musiciens, le violoniste Oleg Kagan et son épouse, la violoncelliste Natacha Gutman, l'altiste Youri Bashmet, les pianistes Zoltan Kocsis, Andreï Gavrilov, Elizabeth Leonskaïa, qu'il contribue à se faire une réputation, ainsi qu'avec les chefs d'orchestre les plus prestigieux. Depuis le début des années quatre-vingt, il ne se produit plus qu'avec partition sur le pupitre, dans des salles à peu près obscures où l'on distingue à peine sa silhouette massive, créant ainsi une atmosphère saisissante, tout en étant convaincu qu'il épargne au spectateur la tentation de se laisser aller aux démons du voyeurisme.

tournage de "Richter, l'insoumis" - Antibes, 1997
La firme Yamaha met à sa disposition permanente deux grands pianos de concert qui l'accompagnent (avec les techniciens préposés à leur entretien!) partout où sa fantaisie lui dicte de se rendre. Partout? Sauf lorsqu'à plus de soixante-dix ans, il quitte Moscou en voiture pour n'y revenir que six mois plus tard. Dans l'intervalle, il aura couvert le trajet jusqu'à Vladivostok et retour, sans compter une courte escapade au Japon, dans des conditions qu'on ose tout juste imaginer, et donné cent cinquante concerts dans les villes mais aussi les bourgades les plus reculées de la Sibérie. Le missionnaire a préféré la ferveur de Novokouznetzk, Kourgan, Krasnoïarsk, Tchita et Irkoutsk, aux acclamations frelatées de Carnegie Hall.
Bruno Monsaingeon. 4 octobre 2002
à propos du film « Richter, l'insoumis »
sur Sviatoslav Richter :
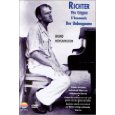 Richter, L'insoumis
Richter, L'insoumis
Portrait de Sviatoslav Richter
160' Date: 1995/1998
- réédition courant 2011 -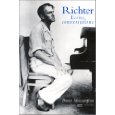 Richter, écrits et conversations
Richter, écrits et conversations
éditions Van de Velde / Arte Editions / Actes Sud, 1998